travailleurs prioritaires
Approche sexuée des conditions de travail
Si le droit vise une égalité au travail entre femmes et hommes, les données montrent que femmes et hommes ne sont pas exposés aux mêmes contraintes et, en conséquence, n’en subissent pas les mêmes conséquences. L’approche par le genre est une opportunité pour comprendre ses différences de situations et ainsi mieux agir sur les conditions de travail. L’action vise ainsi à développer les connaissances et les compétences régionales pour appuyer sur un levier supplémentaire de prévention.
Chiffres clefs
– 27 % des AT pour les hommes et + 41 % pour les femmes entre 2001 et 2019 (1)
Prévalence de 1,1 chez les hommes de 2,5 chez les femmes des affections « souffrance psychique ».
21 % des femmes ne reprennent pas le travail après un cancer un an après l’arrêt des traitements.
(1) Source Anact à partir des données de la Direction des risques professionnels de l’Assurance maladie-risques professionnels.
Enjeux
Quel intérêt à développer une approche par le genre des conditions de travail ?
- Les obligations réglementaires et légales sont faiblement appropriées par les entreprises et les préventeurs. Au-delà des obligations en faveur de l’égalité professionnelle femmes – hommes, il y a peu de prise en compte du genre dans l’évaluation des risques professionnels (Code du travail, art. L. 4121-3).
- Afin de renforcer la prévention au travers d’une analyse d’indicateurs relatifs aux expositions aux risques et leurs impacts selon le sexe. Les données, essentiellement nationales, nécessitent une production et une analyse régionale.
Par exemple, la baisse globale des accidents du travail entre 2001 et 2019 (-11 %) masque des différences significatives selon les sexes : hommes (-27 %) et femmes (+ 41 %). De même, les secteurs accidentogènes ne sont pas les mêmes pour les femmes (santé, action sociale, nettoyage, travail temporaire) et les hommes (BTP). En lien avec le harcèlement (moral ou sexuel) et les agissements sexistes touchent principalement les femmes.
La prévention de la désinsertion professionnelle mérite elle aussi une approche par le genre : 21 % des femmes ne reprennent pas le travail après un cancer un an après l’arrêt des traitements. En cause : les symptômes psychologiques, la nature de l’activité, le temps de travail et la nature des traitements.
Objectifs
Une approche régionale par le genre permet :
- D’identifier les approches et pratiques, ainsi que leurs apports et limites, au regard de la thématique du renforcement de la prévention primaire.
- De stabiliser et de proposer une approche partagée qui croise les enjeux de l’égalité femmes / hommes et du renforcement de la prévention primaire pour toutes et tous.
- De favoriser l’appropriation de l’approche par le genre par toutes les parties prenantes de la santé au travail à l’échelle des gouvernances et du terrain (préventeurs, entreprises, etc.).
Programme
Partager au sein du comité technique une approche par le genre des conditions de travail (fin 2022 – début 2023) : définition, état des lieux régional (pour objectiver et orienter les actions), freins et leviers à l’investissement du sujet par les préventeurs et les entreprises.
Sensibiliser et former les acteurs de la prévention et de l’entreprise et l’inspection du travail (2023 – 2024) : partager des repères, des expériences, notamment pour enrichir la compréhension des freins et leviers à l’appropriation de l’approche par le genre :
- Sensibilisation du Croct, des préventeurs, de l’inspection du travail, des organisations patronales et syndicales, des entreprises (cible à définir en fonction de l’état des lieux).
- Montée en compétences des préventeurs : modalités à définir, en privilégiant la co-construction de méthodologies d’intervention et l’expérimentation.
Outiller les entreprises (2024-2025) : les aider à concrétiser les démarches et les actions au regard de leurs besoins (modalités et contenu à définir : repérer et partager les enjeux spécifiques, construire des données sexuées, intégrer la question du genre dans l’identification et l’analyse des risques, déployer des mesures de prévention…).
Bilan
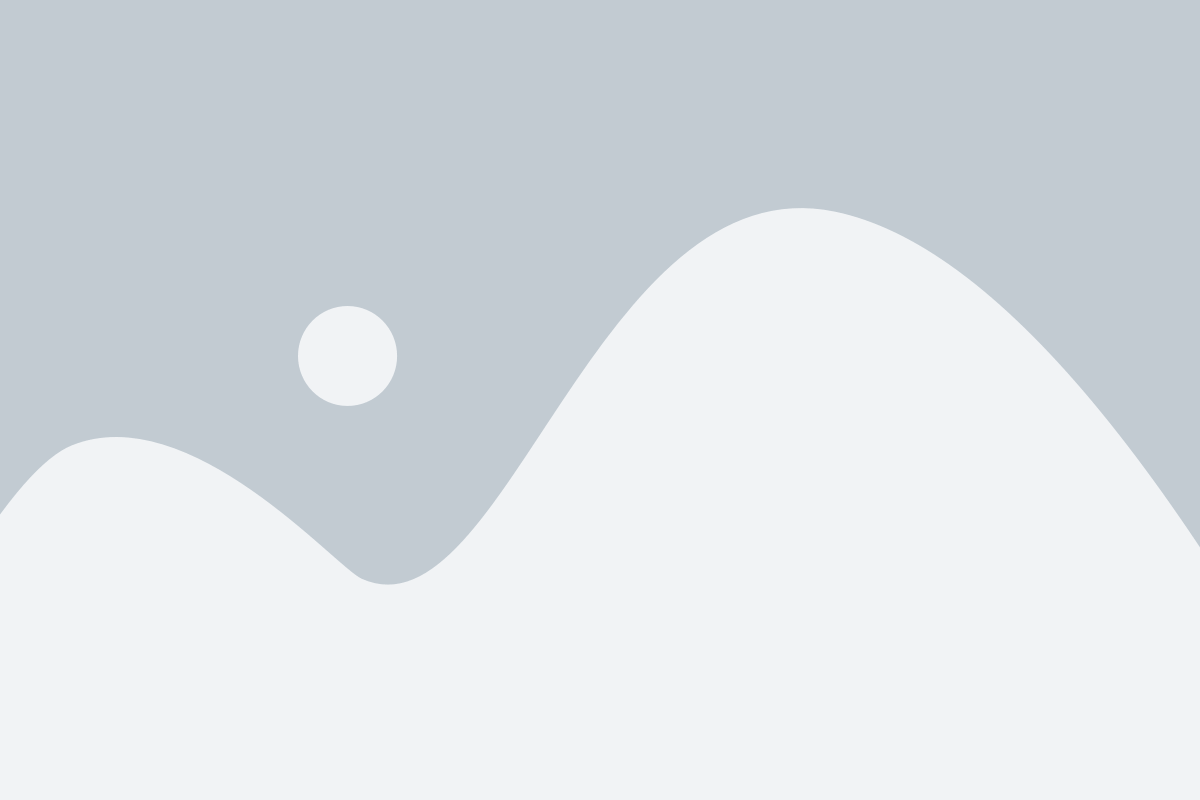
Ressources
Livrables et indicateurs
Nombre : de sensibilisations et de participants, de formations ou d’actions et de participants permettant la montée en compétences, d’entreprises participant aux expérimentations avec les préventeurs.
Livrables : contenu et modalités à définir, à la suite de la 1ère phase de partage de l’approche par le genre des conditions de travail. Supports de sensibilisation et documents de communication associés. Supports de formation ou d’actions permettant la montée en compétences. Ingénierie et méthodologie d’accompagnement.
Animateur(s) et contributeurs
Aract (A), Dreets, Conseil Recherche Ingénierie Formation pour l’égalité entre femmes et hommes (Corif), PST 59, Région (participation à venir à confirmer).
Opco Santé si la formation est une modalité retenue pour développer les compétences sur le sujet au sein des SPST (à construire).
Les comités techniques au sein desquels une coordination est particulièrement nécessaire : ceux dédiés à la prévention secondaire et tertiaire de la désinsertion professionnelle, et au lien entre le PRITH et le PRST 4.
